Les produits durables et de qualité au sens de l’objectif fixé par la loi EGalim sont ceux bénéficiant des labels / certifications / mentions suivantes :
 Produits issus de l’agriculture biologique ou en conversion
Produits issus de l’agriculture biologique ou en conversion
 Label rouge – Signe national qui atteste qu’un produit possède un ensemble de caractéristiques spécifiques établissant un niveau de qualité supérieur à celui d’un produit similaire.
Label rouge – Signe national qui atteste qu’un produit possède un ensemble de caractéristiques spécifiques établissant un niveau de qualité supérieur à celui d’un produit similaire.
 Appellation d’origine (AOP/AOC) – L’Appellation d’origine protégée (AOP) désigne un produit dont toutes les étapes de production sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même aire géographique, qui donne ses caractéristiques au produit.
Appellation d’origine (AOP/AOC) – L’Appellation d’origine protégée (AOP) désigne un produit dont toutes les étapes de production sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même aire géographique, qui donne ses caractéristiques au produit.
 Indication géographique (IGP) – L’Indication géographique protégée (IGP) identifie un produit agricole, brut ou transformé, dont la qualité, la réputation ou d’autres caractéristiques sont liées à son origine géographique.
Indication géographique (IGP) – L’Indication géographique protégée (IGP) identifie un produit agricole, brut ou transformé, dont la qualité, la réputation ou d’autres caractéristiques sont liées à son origine géographique.
 Spécialité traditionnelle garantie (STG) – Un produit dont les qualités spécifiques sont liées à une composition, des méthodes de fabrication ou de transformation fondées sur une tradition.
Spécialité traditionnelle garantie (STG) – Un produit dont les qualités spécifiques sont liées à une composition, des méthodes de fabrication ou de transformation fondées sur une tradition.
 Certification produit « issu d’une exploitation à Haute Valeur Environnementale » (HVE) ainsi que, jusqu’au 31 décembre 2026, certification environnementale de niveau 2.
Certification produit « issu d’une exploitation à Haute Valeur Environnementale » (HVE) ainsi que, jusqu’au 31 décembre 2026, certification environnementale de niveau 2.
 Écolabel pêche durable
Écolabel pêche durable
 « Région ultrapériphérique » (RUP) – Produits issus de 9 régions ultrapériphériques à l’UE (Azores, Madères, Canaries, Guadeloupe, Guyane, Martinique, à la Réunion, à Mayotte, Saint-Martin)
« Région ultrapériphérique » (RUP) – Produits issus de 9 régions ultrapériphériques à l’UE (Azores, Madères, Canaries, Guadeloupe, Guyane, Martinique, à la Réunion, à Mayotte, Saint-Martin)
 Commerce Équitable
Commerce Équitable
 Mention « fermier » ou « produit de la ferme » ou « produit à la ferme ».
Mention « fermier » ou « produit de la ferme » ou « produit à la ferme ».
D’autres catégories permettent de comptabiliser les produits durables et de qualité, produits qui auront fait l’objet d’une sélection particulière lors de la procédure d’achat :
 Produit acquis suivant des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie (production, transformation, conditionnement, transport, stockage, utilisation) – L’article 2152-10 du code de la commande publique dispose que, pour l’évaluation du coût du cycle de vie des produits, les acheteurs s’appuient sur une méthode accessible à tous, fondée sur des critères non-discriminatoires et vérifiables de manière objective et qui n’implique, pour les soumissionnaires, qu’un effort raisonnable dans la fourniture des données demandées. Ni la loi EGalim, ni le code de la commande publique n’imposent de soumettre la méthodologie de calcul du coût des externalités environnementales liées aux produits à une validation de l’administration. Dès lors qu’ils respectent les exigences du code de la commande publique, les acheteurs ayant recours à ce mode de sélection sont libres de définir les modalités qui leur semblent les plus pertinentes sous leur responsabilité. Certaines démarches collectives et/ou certains fournisseurs accompagnent déjà les acheteurs dans la mise en place d’une méthode.
Produit acquis suivant des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie (production, transformation, conditionnement, transport, stockage, utilisation) – L’article 2152-10 du code de la commande publique dispose que, pour l’évaluation du coût du cycle de vie des produits, les acheteurs s’appuient sur une méthode accessible à tous, fondée sur des critères non-discriminatoires et vérifiables de manière objective et qui n’implique, pour les soumissionnaires, qu’un effort raisonnable dans la fourniture des données demandées. Ni la loi EGalim, ni le code de la commande publique n’imposent de soumettre la méthodologie de calcul du coût des externalités environnementales liées aux produits à une validation de l’administration. Dès lors qu’ils respectent les exigences du code de la commande publique, les acheteurs ayant recours à ce mode de sélection sont libres de définir les modalités qui leur semblent les plus pertinentes sous leur responsabilité. Certaines démarches collectives et/ou certains fournisseurs accompagnent déjà les acheteurs dans la mise en place d’une méthode.
 Produits acquis principalement sur la base de leurs performances en matière environnementale et d’approvisionnements directs. Comme pour la catégorie précédente, les acheteurs s’appuient sur une méthode, qu’ils définissent, pour évaluer les deux critères cumulatifs (performance en matière environnementale et performance en matière d’approvisionnements directs), en fonction de caractéristiques non-discriminatoires, vérifiables de manière objective et qui n’impliquent, pour les soumissionnaires, qu’un effort raisonnable dans la fourniture des données demandées. Ni la loi EGalim, ni le code de la commande publique n’imposent de soumettre la méthodologie d’évaluation des performances en matière de protection de l’environnement et de développement des approvisionnements directs liées aux produits à une validation de l’administration. Dès lors qu’ils respectent les exigences du code de la commande publique, les acheteurs ayant recours à ce mode de sélection sont libres de définir les modalités qui leur semblent les plus pertinentes sous leur responsabilité.
Produits acquis principalement sur la base de leurs performances en matière environnementale et d’approvisionnements directs. Comme pour la catégorie précédente, les acheteurs s’appuient sur une méthode, qu’ils définissent, pour évaluer les deux critères cumulatifs (performance en matière environnementale et performance en matière d’approvisionnements directs), en fonction de caractéristiques non-discriminatoires, vérifiables de manière objective et qui n’impliquent, pour les soumissionnaires, qu’un effort raisonnable dans la fourniture des données demandées. Ni la loi EGalim, ni le code de la commande publique n’imposent de soumettre la méthodologie d’évaluation des performances en matière de protection de l’environnement et de développement des approvisionnements directs liées aux produits à une validation de l’administration. Dès lors qu’ils respectent les exigences du code de la commande publique, les acheteurs ayant recours à ce mode de sélection sont libres de définir les modalités qui leur semblent les plus pertinentes sous leur responsabilité.
- Produits équivalents aux produits bénéficiant des labels, certifications ou mentions, en accord avec le code de la commande publique.
Attention : les produits MSC et Bleu Blanc Cœur ne sont pas intégrés directement en tant que produits de qualité et durables. L’acheteur doit justifier son classement pour chaque produit avant de pouvoir les comptabiliser dans les catégories liées aux coûts des externalités environnementales ou liées à leur performance environnementale.
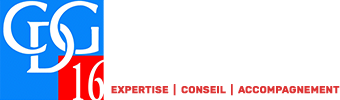

 Equilibre alimentaire
Equilibre alimentaire Afin de faciliter la vérification du respect de ces règles de conception, il est possible d’utiliser les tableaux de fréquences du GEM-RCN que vous trouverez dans la
Afin de faciliter la vérification du respect de ces règles de conception, il est possible d’utiliser les tableaux de fréquences du GEM-RCN que vous trouverez dans la  Label rouge – Signe national qui atteste qu’un produit possède un ensemble de caractéristiques spécifiques établissant un niveau de qualité supérieur à celui d’un produit similaire.
Label rouge – Signe national qui atteste qu’un produit possède un ensemble de caractéristiques spécifiques établissant un niveau de qualité supérieur à celui d’un produit similaire. Appellation d’origine (AOP/AOC) – L’Appellation d’origine protégée (AOP) désigne un produit dont toutes les étapes de production sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même aire géographique, qui donne ses caractéristiques au produit.
Appellation d’origine (AOP/AOC) – L’Appellation d’origine protégée (AOP) désigne un produit dont toutes les étapes de production sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même aire géographique, qui donne ses caractéristiques au produit. Indication géographique (IGP) – L’Indication géographique protégée (IGP) identifie un produit agricole, brut ou transformé, dont la qualité, la réputation ou d’autres caractéristiques sont liées à son origine géographique.
Indication géographique (IGP) – L’Indication géographique protégée (IGP) identifie un produit agricole, brut ou transformé, dont la qualité, la réputation ou d’autres caractéristiques sont liées à son origine géographique. Spécialité traditionnelle garantie (STG) – Un produit dont les qualités spécifiques sont liées à une composition, des méthodes de fabrication ou de transformation fondées sur une tradition.
Spécialité traditionnelle garantie (STG) – Un produit dont les qualités spécifiques sont liées à une composition, des méthodes de fabrication ou de transformation fondées sur une tradition. Certification produit « issu d’une exploitation à Haute Valeur Environnementale » (HVE) ainsi que, jusqu’au 31 décembre 2026, certification environnementale de niveau 2.
Certification produit « issu d’une exploitation à Haute Valeur Environnementale » (HVE) ainsi que, jusqu’au 31 décembre 2026, certification environnementale de niveau 2. Écolabel pêche durable
Écolabel pêche durable « Région ultrapériphérique » (RUP) – Produits issus de 9 régions ultrapériphériques à l’UE (Azores, Madères, Canaries, Guadeloupe, Guyane, Martinique, à la Réunion, à Mayotte, Saint-Martin)
« Région ultrapériphérique » (RUP) – Produits issus de 9 régions ultrapériphériques à l’UE (Azores, Madères, Canaries, Guadeloupe, Guyane, Martinique, à la Réunion, à Mayotte, Saint-Martin) Commerce Équitable
Commerce Équitable Communication
Communication Réduction du gaspillage alimentaire et des déchets plastiques
Réduction du gaspillage alimentaire et des déchets plastiques